Glossaire -
Biographies
les Abbesses
Photos
- Val de Grâce
 - Présentation
- Présentation
* Culte : Catholique Romain
* Début de la construction : (1624)
* Fin des travaux : (1667)
* Style : Classique et Baroque
* Date de désacralisation : (1790)
* Protection : Classé Monument Historique (1974), (1990)
- Situation
* Pays : France
* Région : Ile de France
* Ville : 5ème arrondissement Paris
- Le Voeux d'Anne d'Autriche
Son église est le fruit du Voeu. En
(1621), Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII,
favorise l'installation à Paris de la communauté des
Bénédictines du couvent du Val de Grâce de la
Crèche à Bièvres, elle s'établit en
l'hôtel Médiéval du Petit Bourbon, au faubourg St
Jacques. En (1624), la Reine pose la 1ère pierre de ce qui,
sans doute, forme aujourd'hui le plus bel ensemble Conventuel
Français du (XVIIème siècle). Son église
est le fruit du voeu qu'avait fait la Reine d'élever à
Dieu un temple magnifique s'il lui envoyait un Fils. Après
23 ans de mariage, en (1638)
, naquit le futur Louis XIV qui posa la 1ère pierre le 1er
Avril (1645) et la construction s'acheva à la fin des
années (1660) par la décoration sculpturale et picturale.
Les travaux furent tout d'abord confiés à Mansart, en
creusant les fondations il découvrit les importants vides
laissés sous terre par des générations de carriers.
Ces
vides furent sondés, cartographiés puis consolidés
en l'aplomb des futurs bâtiments. Mais les fortunes
dépensées par Mansart dans ces confortations
imprévues lui firent retirer l'affaire au profit de Lemercier,
qui avait bâti notamment l'hôtel de St Aignan, et la
bibliothèque de Mazarin puis le Muet
, assisté de le Duc. En (1649), les troubles de la Fronde
entraînèrent une longue interruption des travaux qui ne
reprirent qu'en (1655).Les sculptures extérieures sont
signées Philippe Buyster, les sculptures intérieures sont
dues à Michel et François Anguier. Le Maître Autel,
de (1663), est de le Duc et la coupole, la gloire du Val de
Grâce, représentant la Ste Trinité au Paradis
entourée de l'Eglise Triomphante, avec 200 personnages des
2 testaments, fut peinte par Mignard, toujours en (1663).
Molière lui dédia un poème.
La
chapelle Ste Scholastique, patronne des Bénédictines, et
Oratoire de la Reine, renferme des peintures murales de paysages
méditerranéens attribuées à Dufresnoy. La
peinture de la demi coupole de la chapelle du St sacrement est due au
neveu de Philippe de Champaigne. Le magnifique pavage de
l'église est de Nicholas Pasquier. L'Abbaye du Val de
Grâce possède 6 tableaux de Philippe de Champaigne, dont
4 sont exposés dans l'église:
* l'Ascension.
* la Pentecôte.
* l'Entrée du Christ à Jérusalem.
* Jésus et la Cananéenne.
L'Abbaye fut
dévolue, par la Convention le 31 Juillet (1793), au service de
santé des armées, ce qui la sauva très
probablement de la destruction. Elle abrite aujourd'hui l'Ecole
d'Application du Service de Santé des Armées, le
musée du service de santé et la bibliothèque
centrale.
- L'Abbaye
Célèbre
et prospère jusqu'à la fin du (XVIIIème
siècle), l'Abbaye "N.D.du Val de Grâce", pourtant
Mausolée Royal comme la basilique de St Denis, fut
épargnée par les destructions Révolutionnaires, en
devenant hôpital militaire, l'ensemble architectural du Val de
Grâce était préservé, mieux encore que
l'Abbaye voisine de Port Royal devenue en (1795) maison pour enfants
trouvés, puis maternité en (1818), alors que
disparaissaient totalement les couvents des Feuillantines, des
Ursulines et des Carmélites du quartier St Jacques. Il fut sans
conteste le plus ambitieux des grands chantiers religieux de la
Capitale. Autrefois témoignage d'une Royale dévotion, cet
ensemble admirable
par l'ampleur de son monastère, par la magnificence de son
église et surtout par la haute maîtrise des ateliers qui y
travaillèrent, est aujourd'hui reconnu comme, une des plus
belles réussites artistiques du siècle de Louis XIII.
Cette vaste entreprise réunit les meilleurs artistes connus
à Paris au milieu du (XVIIème siècle), les
architectes Mansart, Lemercier, le Muet, les sculpteurs issus de la
maîtrise, les frères Anguier de la ville Royale d'Eu et le
flamand de Buyster, les peintres religieux Jean Baptiste et Philippe de
Champaigne, Pierre Mignard le Romain, et beaucoup d'autres encore,
maîtres artisans des grandes corporations appelés plus
tard à Versailles. Le 31 Juillet (1793), la Convention prit la
décision capitale d'affecter les bâtiments du couvent du
Val de Grâce à un Hôpital Militaire. La
construction de (1974) à (1978) d'un hôpital neuf et
indépendant, permit de rendre à l'ensemble
monastique son autonomie. Une complète et récente restauration en (1996), acheva
de lui rendre sa beauté.
- Chronologie.
* 1624 :
La Reine Anne d'Autriche pose la 1ère pierre du monastère sur le
site de l'hôtel du Petit Bourbon.
* 1643 :
A la mort du Roi Louis XIII, la Reine Anne d'Autriche devient Régente du
Royaume. Elle demande à François Mansart les plans du monastère.
* 1645 :
François Mansart présente les plans d'un vaste monastère palais qui est
écarté. Il est décidé de construire une nouvelle église, dont le
jeune Roi Louis XIV pose la 1ère pierre, suivant les plans de François Mansart.
* 1646 :
François Mansart est écarté de la direction du chantier. Il est remplacé
par Jacques Lemercier, 1er architecte du Roi. Il poursuit les travaux suivant les dessins
de Mansart. Les travaux s'arrêtent pendant la Fronde. L'église n'est réalisé que jusqu'au 1er ordre.
* 1654 : Janvier
Mort de Lemercier. Les travaux reprennent sous la direction de
Pierre le Muet secondé par Gabriel le Duc, qui revient de Rome, et Antoine
Broutel du Val. Pierre le Muet modifie le plan de Mansart pour la tour de la Lanterne, du Dôme, et des voûtes.
* 1655 :
Travaux d'agrandissement du monastère, réservoir, nouvel appartement de la Reine,
dortoirs, aile Sud, suivant les plans de le Muet.
* 1662 :
Le gros oeuvre est terminé. Michel Anguier signe les contrats pour la
sculpture des arcades, des voûtes et des pendentifs de la croisée.
* 1662 à 1663 :
Surélévation de l'aile Ouest du monastère.
* 1663 :
Pierre Mignard signe le marché de la fresque de la coupole
du dôme.
* 1663 Août :
Le projet de Baldaquin au dessus du maître autel proposé par le Muet et le Duc est
approuvé par la Reine.
* 1664 :
Marché pour le pavement de marbre de l'église.
* 1665 13 Juin :
Visite de le Bernin. le Duc lui présente le dôme comme fait de la proportion de
celui de St Pierre de Rome. le Bernin fait un projet de
baldaquin pour le maître autel qui n'est pas retenu.
* 1666 :
Mort d'Anne d'Autriche. Colbert passe les derniers contrats pour le maître autel,
le pavillon Nord-Ouest, les 2 corps qui encadrent l'église
et la grille qui ferme la cour devant l'église.
* 1669 : Mort de le Muet et fin des travaux.
* 1793 :
Destruction du maître autel qui sera reconstitué par
Robert Ruprich. Le baldaquin subsiste à la révolution dépouillé des armes de la Reine.
- L'Abbaye un palais et un Couvent pour une Reine.
L'escalier dit de Mansart
fut construit pour les besoins des ouvriers. C'est aujourd'hui le plus
important des escaliers donnant accès aux carrières, 19
mètres de haut, 2 mètres de large, 30 mètres
de long, 3 groupes de chacun 16, 17 et 18 marches. Le ciel est
soutenu de place en place par des arcs surbaissés. En (1988), il
a fait l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques.
Le puits
que l'on surnomme "trou de service de Madame la Reine" est en fait
l'ancienne fosse d'aisance des appartements privés que la Reine,
Anne d'Autriche, habita au Val de Grâce. Un peu plus loin est
un puits de service à échelons dans lequel passe une
tuyauterie qui, à la surface, communique avec le service des
bains et, dans la carrière, avec 4 énormes cylindres en
tôle, destinés à maintenir l'eau à
température constante des souterrains 13 degrés. Cette
activité cessa au cours du (XXème siècle).
Haut de page
|
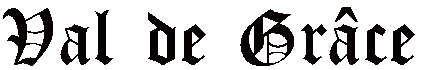
 - Présentation
- Présentation