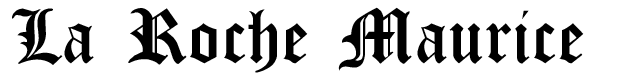Glossaire
Photos

- Rochois
- Situation
* Pays : France
* Région : Bretagne
* Département : Finistère
* Arrondissement : Brest
* Canton : Landerneau
* Intercommunalité : Pays de Landerneau Daoulas
- Historique
La Roche Maurice vient du "Breton" "rob = forteresse" et de "Morvan = Maurice".
Elle est un démembrement de l'ancienne
paroisse primitive de Ploudiry. C’est seulement au (XIVème siècle) qu’apparaît le nom de La Roche Maurice.
Ce nom semble lié à la présence d’une forteresse surnommée "Roch'Morvan" et édifiée dès le (XIème siècle) par Morvan,
Maurice, en Français, Vicomte du Faou. Elle tombe aux mains des Vicomtes de Léon dès le (XIIème siècle). La Roche
passe aux Rohan, par le mariage d'une fille d'Hervé VII du Léon. En (1472), le Duc de Bretagne François II dépossède,
pour un temps, les Rohan au profit de son écuyer Loys de Rosnivinen. Retournée aux Rohan, la forteresse est
démantelée en (1490) par ordre du Roi, à cause de l'ombrage fait à Brest.
Sous l'Ancien Régime, La Roche Maurice
était une trève de la paroisse de Ploudiry et dépendait de l'ancien évêché de
Léon. L'église avait pour titulaire St Yves dès (1363). Le statut de paroisse lui est accordé au Concordat. La
commune de la Roche Maurice est formée de l’ancienne trève de ce nom augmentée de la trève de Pont Christ, dont la
chapelle est fondée en (1533) par le seigneur de Brézal, et d’une portion de la paroisse de Plounéventer.
On trouve les appellations suivantes
Rupes Morvan en (1263), Rocha Morvani en (1281), Rocha Morvam en (1363),
la Roche Morice en (1359), la Roche Maurice en (1421). Ce n'est qu'en (1341) qu'apparaît le nom de La
Roche Maurice, il est postérieur à celui de "Roc'h Morvan - Rupe Morvan" en (1263).
- l'Ossuaire
Il date du (XVIIème siècle) (1639)-(1640), édifiée par l'atelier de l'Elorn. Elle est de plan
Rectangulaire, avec un modeste clocheton et des lanternons d'angle inégalement inachevés. Elle porte l'inscription
"Memor esto Judich mei sic erit et tuum mihi hodie tibi Cras (1639)". Au dessus de la porte du pignon, se trouve
l'inscription "Memento homo quia pulvis es (1640)". Il s'agit de l'ancienne chapelle Ste Anne. La porte de la façade
principale est surmontée d'un fronton Triangulaire sous lequel figure l'inscription "Rappelle toi mon jugement,
tel aussi sera le tien, à mon tour aujourd'hui, à ton tour demain", puis la date de (1639). Le soubassement de cette
façade porte une galerie de 7 personnages représentant les différentes conditions sociales et tous tributaires de
la mort qui est représentée à l'angle du contrefort Sud par un Ankou, squelette brandissant un dard et proclamant
"Je vous tue tous". Au dessus de la porte du pignon Sud se trouve une autre inscription latine datée de (1640),
"Souviens-toi, homme que tu n'es que poussière".
- l'Eglise
L'édifice, dédié à St Yves, date du (XVIème siècle) et fut édifié de (1509) à (1589) à
l'emplacement de l'église ou chapelle Castrale de (1363), fondée par la famille Rohan, seigneurs héritiers des
Vicomtes de Léon, testament d'Hervé VIII de Léon. Il s'agit d'un édifice de forme Rectangulaire à 3 vaisseaux
lambrissés, nef de 3 travées avec bas côtés, séparée par le jubé d'un choeur de 2 travées avec bas côtés,
construite pour l'essentiel dans le 2ème tiers du (XVIème siècle). Les armoiries de l'autel Nord sont celles de
Le Gac de Keraoul (1545). Le retable du maître autel est signé J.Berthouloux, Brest, (1650). La maîtresse vitre porte
la date de (1539) et les sablières portent les inscriptions suivantes, "Ia(n) Le Boell. G A(n) Lan MILVLXI ;
A. Rollant 1559 ; (1561) H. H. Elaere. Le Men". Les sablières, ornées de scènes de la vie quotidienne, datent de (1559)
et (1561). Le clocher, qui porte la date de (1589), d'une hauteur de 60m , possède 2 étages de cloches,
2 galeries et une haute flèche octogonale et dentelée.
La porte occidentale de l'église
datée de (1550), est signée, Ateliers Prigent, ornée de colonnes ioniques datée de (1589), et surmontée de
niches abritant les statues de St Yves, St Pascal Baylon et St Vincent Ferrier. Le portail Sud est daté de (1550)-(1554).
Le bénitier du portail Méridional, oeuvre de A.Men, date de (1520)-(1530), le dais du bénitier s'orne de 4 bustes
et est surmonté de la statue de St Maudez ou Maurice, en tenue d'Abbé, sculpté par le Maître de Locmaria-Lan en (1520).
- la Verrière
Le vitrail, daté de (1539), est signé
Laurent Sodec, peintre verrier de Quimper. Il est réalisé suite à une commande des fabriciens Allain et Joce comme
l'atteste l'inscription "En l'an mil Vcc XXXIX fut fet cette vitre et estoet de fabrique por lors Allen. Joce. L.S.".
Sa surface est de 21m,05 et comporte 15 scènes représentant la Passion et la Résurrection du Christ. A noter que
le tympan, brisé lors de la Révolution, fut reconstitué par le verrier parisien Luçon en (1950). Y figurent les 14 blasons des
Rohan et des familles alliées. Les 5 lancettes présentent un récit détaillé de la Passion et la
Crucifixion occupe les 2 registres supérieurs des 3 lancettes centrales.
- les Voûtes
Les voûtes lambrissées comportent des
sablières et poutres sculptées de scènes de la vie quotidienne (1559)-(1561). La sablière du Midi porte la mention
B.Rolland (1559), dans la nef, du côté du jubé. La sablière du collatéral Nord est signée Fiacre le Men (1561). Au
delà du jubé, dans le bas côté Nord, on reconnaît le Boeuf de Luc, le Lion de Marc et l'Aigle de Jean. La seconde
série, en deçà du jubé, porte des scènes vivantes, scènes de labourage, enterrement d'un cadavre aux jambes croisées
et allongé sur une charrette tirée par 2 chevaux. Le détail le plus intéressant se révèle vers la fin de cette
sablière, le charpentier, maillet en main, est accompagné des inscriptions suivantes, pour les "Sarpanters,
Jacques le Born, Gouverneur, A l'An MVLXI. Fiacr. Menn" - "pour les charpentiers. Jacques Le Born (1561), Fiacre Le Menn".
Sur le bas côté Sud, d'autres scènes, joueur de tambour, sonneur de biniou, fardier et futailles, lutteurs au bâton.
- le Jubé
Clôture en chêne polychrome qui sépare le choeur de la nef, date du (XVIème siècle). On remarque sous
la tribune la surabondance des figures grotesques et fabuleuses.
* Côté nef et dans les niches de la galerie, se trouvent les 9 Apôtres, de gauche à droite :
Philippe, André, Thomas, Jude, Matthieu, Jacques le mineur, Mathhias, Simon, Jacques le majeur, et sans doute 3 Papes,
personnages assis, coiffés d'une tiare dans des niches.
* Côté choeur et dans les niches de la galerie, se trouvent de nombreux Saints vénérés en Bretagne,
St Paul Aurélien et son Dragon, St Augustin ou St Blaise, St Christophe, St Michel terrassant
le Dragon, Marie Madeleine et son Vase, le Christ ressuscité, Ste Catherine, Ste Barbe et sa Tour,
Ste Apolline et les Tenailles de son supplice, St Dominique ou St Gilles, Ste Geneviève et son Cierge
inextinguible, Ste Marguerite et son Dragon.
- le Mobilier
Si le coffre du maître autel a été refait au (XIXème siècle), le retable aux niches vides qui
l'accompagne, pourrait être de Jean Bertouloux, sculpteur à Brest au milieu du (XVIIème siècle). L'autel conciliaire
est orné dans 3 panneaux Néo Gothiques des vertus Théologales, Foi, Espérances et Charité. L'autel du Nord,
installé vers (1970), est daté de (1545) et porte les armoiries des Le Gac de Kerraoul, paroisse de la Roche Maurice.
Les stalles qui dataient du (XVIIIème siècle) ont été démantelées, 7 sièges ont été appuyés au mur Sud et l'appui
de 5 panneaux collé au Nord. La chaire à prêcher date du (XVIIème siècle)-(XVIIIème siècle). La cuve des anciens fonds baptismaux
date du (XVIIème siècle), sert aujourd'hui de bénitier sous le clocher. L'église renferme un calice en argent doré
du (XVIème siècle) avec pied de (1610), poinçon aux initiales de G. D. Guillaume Desboys, et un autre calice du
(XVIIème siècle). Le ciboire date du début du (XVIIème siècle). La chapelle reliquaire, avec poinçon, oeuvre probable
de Y.Ploiber de Morlaix, date du (XVème siècle). L'église abrite aussi une statue ancienne de N.D. de
Bon Secours et un groupe de St Yves entre le Riche et le Pauvre du (XVIème siècle). le Calvaire, des échaliers scellés
entre le Croix du Christ et celle des Larrons.
Haut de page
|