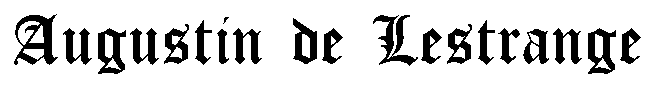- L'Abbé Dom Augustin
 (Né le 19 Janvier (1754), mort le 16 Juillet (†1827).
(Né le 19 Janvier (1754), mort le 16 Juillet (†1827).
Louis-Henri entre au séminaire de Lyon puis fit sa théologie à Saint Sulpice.
Ordonné prêtre en (1778), il devint vicaire à St Sulpice avant d'être nommé en (1780) Grand Vicaire de l'Archevêque de
Vienne, Mgr de Pompignan. La même année il entre à l'abbaye de La Trappe, où il fait profession et devient Maître des
novices en (1785). Quand parut, en (1790), le décret de la Constituante supprimant les voeux de religion, il pressa son
Prieur, Dom Gervais Brunel d'emmener la communauté à l'étranger. Après avoir temporisé, et voyant la situation s'aggraver,
le Prieur donna son accord, et Dom Augustin demanda asile dans le canton de Fribourg pour 24 moines, ce qui lui fut
accordé le 12 Avril (1791). Le groupe s'installa dans l'ancienne chartreuse de La Valsainte, le 1er Juin suivant, et
Dom Augustin fut élu Abbé le 27 Novembre (1794). Il avait juridiction sur toute colonie issue de La Valsainte.
- La Valsainte
Valsainte en Suisse, Chartreuse fondée en (1294) par Gérard 1er de Corbières.
Le monastère fut supprimé par le Saint Siège sur la demande répétée du gouvernement de Fribourg, en (1777). Dom Augustin de
Lestrange obtint l'autorisation, en (1791), de se réfugier dans les bâtiments avec 24 religieux originaires de l'Abbaye de
La Trappe. Un bref pontifical de (1794) érigea le monastère en abbaye de la "congrégation de La Trappe".
Grâce à l'arrivée massive d'exilés les fondations se succédaient depuis (1793). Au début de (1798), les moines durent
s'exiler une nouvelle fois. Après de multiples pérégrinations à travers l'Europe, 87 religieux réoccupèrent la Valsainte
en (1803). A la suite du décret impérial de (1811), La Valsainte fut fermée. Elle fut réouverte en (1814), mais un décret
du Grand Conseil de Fribourg en (1815), posant des conditions peu acceptables, un départ définitif fut décidé, 9 religieux
furent détachés pour réoccuper l'abbaye de La Trappe et, en (1816), un autre groupe restaure Aiguebelle. Devant
l'affluence de postulants, dont beaucoup d'émigrés, il avait fait partir 2 essaims à destination du Canada.
L'un se fixa à Westmalle, en Belgique, en (1793), l'autre à Lulworth en Angleterre en (1794). Il fonda encore d'autres
monastères, dont Darfeld, en Westphalie, en (1795) et une communauté pour les moniales à Sambrancher, Valais, Suisse, en
(1796).
- l'Odyssée monastique.
La Valsainte se développa rapidement et fut à l'origine de plusieurs
fondations, en Westphalie, en Angleterre, en Espagne, au Piémont, etc. A partir de Janvier (1798), la Suisse n'offrait
plus un asile sûr pour les émigrés français. Mettant à profit la présence de la princesse de Condé parmi les moniales
installées à Sembrancher en (1796) et qu'il avait prises sous son autorité, Dom Augustin décida de diriger tout son monde,
moines, moniales, enfants, au total 254 personnes, vers la Russie. Plusieurs colonnes s'ébranlèrent vers l'Est, entre
le 17 Janvier et le 10 Février (1798), par différents itinéraires, avec des points de ralliement.
Le périple fut épuisant, d'autant plus que Dom de Lestrange voulait qu'on suivît les plus fidèlement possible les
Règlements monastiques, et les hommes ne mangeaient souvent qu'une fois par jour, à l'étape du soir, après le coucher du
soleil. On compta une quarantaine de décès pendant toute la période de l'odyssée, il y eut aussi quelques défections.
Le terme du voyage fut atteint par l'avant garde le 20 Septembre Orscha, sur le Dniepr. Le dernier groupe n'arriva qu'en
Juillet (1799). Mais Dom Augustin avait déjà d'autres projets en vue, car il ne lui semblait pas qu'en Russie il aurait
les coudées libres. Il lorgnait sur l'Amérique, et réussit à se faire expulser par le Tsar en Mars (1800).
Les moines, lassés, ne suivirent que modérément les vues de leur Abbé. Seuls 36 passèrent en Amérique en (1803), ceux qui
ne se fixèrent pas en Westphalie reprirent le chemin de Westmalle ou de la Valsainte. Des tentatives de se réimplanter
en France furent faites après le Concordat de (1801), mais Dom de Lestrange s'opposa de front à Napoléon à propos du
serment exigé des Italiens en (1810). Un décret impérial du 28 Juillet (1811) supprima tous les monastères Trappistes de
l'empire. On chercha à arrêter dom Augustin. Après moult péripéties, il débarqua en Amérique en décembre (1813), et ne
revint en France qu'un an plus tard.
- La tourmente Révolutionnaire
Un 1er groupe de moines quitta La Trappe avec Dom Augustin de Lestrange,
le 1er Mai (1791). Un 2ème groupe gagna La Valsainte vers la fin de l'année. D'autres moines quittèrent l'abbaye et
essayèrent de poursuivre ailleurs leur vie monastique, tandis que certains se retirèrent dans leur famille. Les 28 moines
demeurant encore à la Trappe furent expulsés le 3 Juin (1792). Le monastère fut alors vendu et devint une carrière de
pierres. La majorité des moines restèrent fidèles à leurs voeux. Sur 103 profès, 13 se marièrent civilement, mais certains
furent réconciliés lors du Concordat de (1801). Plusieurs prêtres exercèrent clandestinement un ministère sacerdotal. Le
frère Antoine Prudhomme fut guillotiné comme Vendéen. Avec 5 frères de Sept Fons, 3 membres de la communauté de
La Trappe périrent de misère, sur l'Ile Madame, débarqués en août (1794) des fameux "pontons de Rochefort". Sur ces
pontons étaient entassés dans des conditions effroyables plusieurs centaines d'ecclésiastiques. Il s'agissait du Père
Antoine Dujonquoi, ancien Père Maître des Convers, du Frère Eloi Richy, et du Prieur, le Père Gervais Brunel.
Le Père Brunel, ainsi que 2 moines de Sept Fons, furent béatifiés par Jean Paul II, le 1er Octobre (1995), avec 63
autres des quelque 800 déportés.
- L'Abbaye de La Cour Pétral
Dom Augustin de Lestrange, profitant du Concordat signé par Napoléon en
(1801), installa une communauté de moniales à Valenton. Après le décret de proscription de (1811), la communauté se
réfugie d’abord en Bretagne, puis s’installe dans l’ancien monastère Prémontré de Mondaye en Normandie. Les conditions
d’existence dans cette abbaye se dégradèrent fortement, entraînant une forte mortalité. Suite à des accusations
d'autoritarisme, Dom Augustin dut s'expliquer à Rome, et mourut sur le chemin du retour, à Lyon Vaise, le 16 Juillet (†1827).
En (1836), la communauté de Laval envoie des soeurs à Mondaye pour remplacer les survivantes de la période héroïque qui sont
dispersées dans les 3 communautés de moniales dépendantes de La Trappe, Les Gardes, Maubec et Vaise.
Ce remplacement du personnel ne résolvait pas les problèmes de la pauvreté, et Dom Hercelin, abbé de La Trappe, fut obligé
de transférer la communauté à la Cour Pétral, près de Verneuil sur Avre dans l'Eure, en (1845).
Depuis (1861), des chartreux occupent à nouveau les bâtiments
Haut de page
|