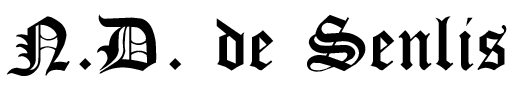Glossaire -
Biographies
Chronologie -
Evêques
Photos
- N.D. de Senlis
- Présentation
* Nom local : Cathédrale Notre Dame de Senlis
* Culte : Catholique Romain
* Type : Ancienne Cathédrale, église Paroissiale depuis (1801)
* Rattachement : Diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis
* Début des travaux : (1153)
* Fin des travaux : 16 Juin (1191)
* Style dominant : Gothique
* Protection : Classée Monument Historique (1840)
- Situation
* Pays: France
* Région : Hauts de France
* Département : Oise
* Ville : Senlis
-Historique
Malgré les
incertitudes qui demeurent quant aux conditions
d'évangélisation de la cité Senlisienne, elle fut
Christianisée au cours du (IVème siècle), ainsi
que le rapporte la tradition, même si le rôle de St Rieul,
généralement considéré comme
l'évangélisateur et le 1er évêque de la
ville, est fortement sujet à caution. C'est à cette date
que la cité accueillit un 1er édifice qui
s'éleva dès l'origine dans le quart Nord Est de la
cité, c'est à dire à son emplacement actuel.
Senlis, passe en (980) aux mains de Hugues Capet,
Senlis connut un essor considérable, sa situation
géographique et stratégique ainsi que les attraits
traditionnels exercés par la proximité de forêts
giboyeuses en firent un lieu de résidence
particulièrement apprécié de la dynastie
Capétienne, qui participa au dynamisme de la ville à
l'aube du nouveau millénaire. Notre Dame est mentionnée
pour la 1ère fois par une addition du (Xème
siècle) figurant dans un Sacramentaire de l'église de
Senlis daté de (880) et conservé à la
bibliothèque Ste Geneviève, à Paris. Elle
bénéficia du dynamisme de la ville autour de cette date,
ainsi que l'atteste à 2 reprises l'Obituaire de
l'église de Senlis. Y sont mentionnés une donation faite
par l'évêque >Constance (965)-(986) et les travaux entrepris
par l'évêque Eudes, sans préciser s'il s'agissait
de Eudes Ier (989)-(993) ou d'Eudes II (1068)-(1069). Cette
imprécision ne fut pas sans conséquence pour l'analyse de
l'actuelle chapelle Octogonale, édifiée au Sud de
Notre Dame.
Une
église répondant au vocable de St Gervais et St Protais,
apparaît dans les textes au (IXème siècle),
attestant l'existence d'une cathédrale double. Des documents
postérieurs associent ce vocable à l'édifice
octogonal situé au Sud de Notre Dame et communément
appelé, chapelle Octogonale. Cet édifice, dont les
parties les plus anciennes sont contemporaines de l'an (1000), fut
identifié, en raison de son plan centré, à
l'ancien Baptistère du groupe cathédral, tandis que la
2ème église était située à
l'ouest de Notre Dame, suivant en cela le modèle parisien
proposé par Jean Hubert. La remise en question de ce
modèle appelle un réexamen de la restitution du groupe
cathédral de Senlis et de la fonction de l'édifice
octogonal autour de, l'an 1000. Le plan centré est l'un des
grands schémas architecturaux de l'Antiquité tardive,
période au cours de laquelle il fut adopté pour des
baptistères et des martyria, cette diversité d'usage
interdit donc d'établir un rapport univoque entre la fonction
d'un édifice et ce parti architectural. Le vocable
associé à cet édifice, sa localisation à
l'écart de l'église cathédrale et
l'évolution du culte des reliques en font plus assurément
une église destinée à conserver dès
l'origine les reliques des 2 Sts Milanais qu'un ancien
baptistère ou une chapelle.
Du
(XIIIème siècle) au (XXème siècle), les modifications et
restaurations, du plan et de l'élévation de N.D.de
Senlis se révèle délicate tant les modifications
subies par l'édifice furent nombreuses au cours des
années (1230), une flèche fut érigée, puis
fut adjoint un transept, lui même largement modifié
à la suite de l'incendie qui éclata en Juin (1504) et
endommagea gravement l'édifice. La cathédrale ne connut
par la suite que des transformations mineures, en (1671), l'actuelle
chapelle du Sacré Coeur fut élevée à
l'emplacement de la tour Gallo Romaine qui abritait probablement la
chapelle St Michel, en (1751), le porche du portail Occidental fut
abattu. A la Révolution, les portails furent mutilés, le
mobilier liturgique fut dispersé. Classée monument
historique en (1837), Notre Dame fit l'objet de restaurations, plus ou
moins heureuses, au cours de la décennie suivante. En
(1845)-(1846), les têtes des statues colonnes,
décapitées en (1793), furent remplacées par celles
réalisées par le sculpteur Robinet, sous la direction de
l'architecte Ramée. En (1847) enfin, la chapelle d'axe fut
remplacée par une chapelle plus profonde.
- la Cathédrale
La cathédrale N.D.de Senlis est composite, ce qui s'explique par
la durée de sa construction. Commencée en (1151), la cathédrale possède déjà son Choeur et sa façade Occidentale
vers (1167). La dédicace a lieu le 16 Juin (1191). C'est ensuite que les délais s'étirent. La cathédrale était
initialement dépourvue de transept, ce qui correspondait à une tentative d'affranchissement du plan en croix latine
qu'on retrouve notamment à Bourges. Dès (1240), on décide l'adjonction de croisillons, ce qui nécessite la modification
des 2ème et 3ème travées de la nef. En (1230), on ajoute également l'étage Octogonal de la tour méridionale de
la façade. En (1504), un incendie cause de nombreux dégâts. Les restaurations ont lieu de (1506) à (1515). En (1520)
est commencée l'édification de la façade du transept Sud. C'est Pierre Chambiges, le fils de Martin Chambiges, auteur
du transept Sud de St Pierre de Beauvais qui en est chargé.
La construction s'achève en (1560) par
la façade Nord. On ajoute encore des chapelles au (XVIIème siècle). Enfin, au (XVIIIème siècle), on blanchit à la chaux
les murs de la cathédrale. Celle-ci, qui cesse ensuite de se modifier, conserve des proportions modestes, dues à la
petite taille du diocèse, et à l'existence de constructions antérieures, par exemple la chapelle
St Gervais et St Protais au Sud, le palais Episcopal au Sud Est. Plusieurs restaurations ont été entreprises
au (XXème siècle) pour sa conservation.
- La façade Occidentale
La façade Occidentale de N.D.de Senlis, assez étroite, appartient
au Gothique Primitif. Le portail est surmonté d'une grande baie à 3 lancettes, d'une petite rose sculptée et d'une
courtine ornée de 4 statues. De part et d'autre, les portails latéraux, dont le tympan est décoré d'arcatures assez
lourdes, sont surplombés d'une baie ouverte puis d'une autre baie, géminée et aveugle et enfin d'une petite rose,
horloge à droite, à la hauteur de celle du portail central. De puissants contreforts rythme verticalement la façade.
Les 2 tours sont de style et de hauteurs différentes.
Au 1er niveau, elles présentent toutes
de 2 baies garnies d'abat sons. Alors que la tour Nord est ensuite coiffée d'une flèche d'ardoises, la tour Sud
comporte encore 2 niveaux. Le 1er , Octogonal, est agrémenté de 4 tourelles d'angles, qui atténuent la
transition avec le plan à base carrée de l'étage inférieur. Le dernier niveau se compose d'une flèche de pierre ajourée
dont les arêtes sont ornées de crochets.
Le portail central se distingue par son
tympan qui fait figure de pionnier dans l'Iconographie du Couronnement de la Vierge. Le tympan représente Marie, déjà
couronnée, qui reçoit la bénédiction de son fils. Plusieurs anges encadrent la scène. La partie gauche du linteau est
consacrée à la Dormition. Elle est très abîmée. On distingue cependant le corps de la Vierge, parfumé à coup d'encensoirs.
2 anges, dans le ciel, tiennent une petite forme humaine entourée de bandelettes. Il pourrait s'agir de l'âme de
la défunte. La partie droite, mieux conservée, montre la Résurrection. Un ange pousse la Vierge par les épaules, tandis
qu'un autre lui prend les pieds. Une foule d'autres anges assistent à la scène.
Dans les ébrasements, on trouve, à gauche,
"Jean Baptiste, Aaron, Moïse et Abraham". A droite se situent "Siméon, Jérémie, Isaïe et David". Tous ces personnages ne sont
pas aisément identifiables, excepté Abraham, qui, prêt à sacrifier son fils, voit son épée retenue par un ange. On peut
aussi remarquer David, qui porte les clous de la croix. Ses jambes croisées rappellent le Jérémie de Moissac.
Sous les statues, on voit des scènes assez détériorées qui représentent le calendrier. Dans les voussures, l'ascendance
du Christ est représentée dans des volutes végétales. Il s'agit de l'arbre de "Jessé". Sur le côté gauche, dans la
voussure extérieure, on observe Abraham qui tient en son sein 3 petites âmes.
- Le transept et le chevet
Les portails Nord et Sud sont strictement symétriques et beaucoup plus
tardifs que la façade Occidentale, ce qui explique la différence de style. Ils sont entourés de colonnes torsadées.
Leur tympan est composé de vitraux. Il est surmonté d'un gâble qui se dresse devant une claire voie complexe,
les arcs du 1er plan, 2 de chaque côté du gâble, n'ont pas la même forme que les baies qu'on aperçoit en
profondeur et qui encadrent des vitraux visibles de l'intérieur. Une grande rose, surplombée d'un pignon orné d'une
balustrade, domine l'ensemble. La nef, très courte, est presque inapparente entre la tour et le transept. Le côté Sud
donne sur une place et le côté Nord sur un jardin. Le chevet a la particularité de présenter, au Nord comme au Sud, une
tourelle qui vient remplacer un des arc boutants. Ceux ci sont larges et peu éloignés de la paroi du Choeur Les Chapelles
Rayonnantes ont un relief peu marqué.
- Visite intérieure
La Nef est très courte. Elle comprend 4 travées assez étroites et
toutes de largeur différente, arc rehaussé dans la 2ème travée, arc en tiers point dans la 4ème . L'arc de la
1ère travée présente un relief que les autres n'ont pas. L'élévation est à 3 niveaux. Les grandes arcades ne
sont pas très hautes. Leurs chapiteaux sont à motifs végétaux. Le triforium ne comporte qu'une baie par travée, devancée
par une petite balustrade. Les fenêtres hautes possèdent alternativement des baies à 3 et à 2 lancettes.
Des voûtes sont également disparates,
puisqu'elles sont quadripartites pour les 2 -1ères travées alors qu'une voûte sexpartite unit les 3ème et
4ème travées. Les collatéraux ne so0nt pas symétriques. A gauche, la nef latérale devient double au niveau de la
2ème travée alors qu'à droite elle ne suit cette évolution qu'à la 3ème . De part et d'autre, les bas côtés
extérieurs présentent des voûtes d'une plus grande complexité que celles des bas côtés qui longent la nef principal.
On peut noter, à gauche, au pied de
l'escalier qui mène à la salle Capitulaire, la clef de voûte pendante accompagnée de petits anges musiciens. Les croisillons
du transept, comportent 2 travées. Les croisées d'ogives ont une structure complexe. Dans les travées, l'élévation est
semblable à celle de la Nef mais les fenêtres hautes ont 4 lancettes. Les murs de fond sont semblables au Sud
et au Nord. Sous les roses des portails, on retrouve les baies internes de la claire voie, aperçues à l'extérieur.
Elles sont devancées par une balustrade sculptée. Les tympans sont vitrés. Seul le tympan Sud présente des vitraux.
Le choeur est sensiblement plus long que
la Nef. Il comporte 5 travées réunies par des voûtes sexpartites, sauf dans la 1ère travée. Le Triforium est ici
privé de la balustrade qui l'ornait dans la nef et dans le transept. Le rond point est à 7 pans. Les motifs végétaux
des chapiteaux sont fins et variés. Le déambulatoire et les Chapelles Rayonnantes sont voûtes d'ogives rondes et un peu
maladroites. La chapelle Axiale exceptée, les Chapelles Rayonnantes sont peu profondes. Dans la 1ère chapelle latérale,
au Sud, on remarque des clefs de voûte pendantes qui rappellent celles du bas côté gauche.
Haut de page
|