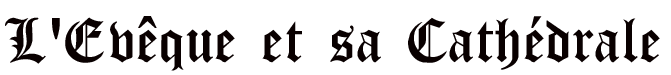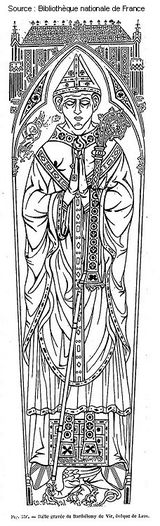Biographies -
Glossaire
Les Bâtiseurs -
Le Gothique -
Glossaire
Le Labyrinthe -
La Clef
Photos
- Origine du mot Cathédrale
L'évêque
et la cathédrale, les 2 termes sont étroitement
liés par l'étymologie, cathédrale dérivant
de cathédra qui désigne le siège à dossier
sur lequel s'assoit l'évêque dans son église, et
qui symbolise à la fois son autorité et sa
présence dans le lieu. Apparu à l'époque
Carolingienne, le terme Cathédrale s'impose
définitivement au détriment des autres expressions,
telles que "mater ecclesia ou ecclesia major, voire ecclesia" simplement,
au cours du (XIIIème siècle), au moment où
s'élèvent de terre dans les villes de France ces immenses
vaisseaux de pierres Gothiques, devenus depuis lors l'archétype
de l'église épiscopale.
Cela
entraîne d'ailleurs quelques abus de langage, comme par exemple
l'habitude de donner à la collégiale de St Quentin, le
nom de Cathédrale, car, ce n'est pas la taille qui fait la
Cathédrale. Au niveau de l'architecture, rien ne permet de
distinguer la Cathédrale d'une autre Eglise. Confusion
renforcée par le fait que la suppression d'un diocèse
n'entraîne pas la disparition du titre de l'église. Ainsi,
la Cathédrale de St Omer n'est plus qu'une église
Paroissiale depuis (1790), et ce n'est qu'en (1553) que cette Abbatiale
(XIIIième siècle) ? (XIVème siècles) accueillit le
siège d'un Diocèse, après que Charles Quint ait
rasé Thérouanne. fait, sur le plan architectural, rien ne
distingue en théorie la cathédrale d'une autre
église.
Encore
de nos jours souvent absent de sa cathédrale,
l'évêque n'a jamais été aussi présent
dans son église qu'aujourd'hui, car par le passé son
absence était la norme. Cette situation eut de nombreuses
conséquences dans l'organisation et l'utilisation du lieu de vie
et de culte qu'est la cathédrale.
L'office
d'évêque, epicopos, dans l'Eglise est très ancien
puisque le "Nouveau Testament" en fait mention sans clairement toutefois
en préciser le rôle "Philippiens I,1; Actes XX, 28; ler
Timothée III, 2; Tite l,7". Sa fonction parmi le collège
des clercs se précise avec les Pères du (XIème
siècle), qui comme Ignace d'Antioche voient en
l'évêque à la fois le 1er Pasteur, le
représentant de l'Eglise face à l'extérieur
symbole de l'unité du peuple chrétien. Cyprien de
Carthage résume cela en déclarant, "l'évêque
est dans l'Eglise, et l'Eglise est dans l'évêque". Cette
double fonction de guide et de représentant les pousse à
insister sur le devoir d'obéissance envers
l'évêque, et permet de mieux comprendre aussi toute la
symbolique qui se développe autour de son église, lieu de
réunion et d'union du peuple chrétien rassemblé.
Si
la fonction liturgique et pastorale de l'évêque a peu
évolué jusqu'à nos jours, son rôle dans la
société a été plus mouvementé. La
victoire du Christianisme fit de l'évêque une
personnalité Publique. C'est aussi à cette époque
qu'apparaissent le 1ères églises épiscopales,
et que commence donc la relation entre l'évêque et la
cathédrale. Cette relation a varié selon les
périodes et s'est transformée en fonction de
l'évolution de la société et du peuple
chrétien. Car l'évêque n'est pas seul dans sa
cathédrale, c'est pourquoi il semble utile d'envisager l'action
de l'évêque dans sa cathédrale en fonction des
acteurs en présence.
- un Groupe de bâtiments
C'est
à la suite de l'édit de Milan (313) qu'apparurent les
1ers bâtiments cultuels publics chrétiens. Le concile
de Nicée (325) institua la règle de
l'évêché urbain installé dans la
cité. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on peut
parler de Cathédrale. Ce n'était pas alors une
église unique, mais un groupe bâtiments, composé de
2 églises et d'un baptistère. Vers (403), Paulin de
Nole décrit ainsi le groupe Cathédrale
élevé par son ami Sulpice Sévère. Le
temple a 2 toits, de même qu'il y a 2 Testaments dans
l'Eglise, mais l'Ancien Testament s'unit au Nouveau dans la grâce
du Christ et c'est pour cela que la fontaine a été
placée au milieu. L'existence des 2 églises semble
s'expliquer par la division de la communauté entre
Fidèles et Catéchumènes, la position de la piscine
baptismale au centre prenant alors son sens.
Dans
des cités désertées par des familles
sénatoriales préférant résider dans leurs
domaines ruraux, les évêques étaient la seule
autorité publique significative, et l'érection du groupe
cathédrale en fit souvent les principaux bâtisseurs de la
ville. Peu à peu, l'évêque accrut son pouvoir
temporel sur la cité. Déjà reconnu par Constantin
arbitre en cas de conflit, il détint bientôt un
véritable pouvoir juridique. Prenant soin des murs de
l'enceinte, des bâtiments publics, il joua aussi un rôle
Energétique.
Grégoire
de Tours se fit ainsi un devoir de reconstruire sa Cathédrale
après un incendie, de restaurer le Baptistère et de
fonder plusieurs églises. Les nobles laïcs
s'intéressaient peu à la Cathédrale,
préférant concentrer leurs dons dans la fonction et
l'enrichissement d'Abbayes. De ces cathédrales primitives, il ne
reste que peu de traces, car elles ont toutes laissé place
à des édifices plus récents, et seule
l'archéologie permet actuellement de les connaître.
Ces
édifices plus récents sont nés pour la plupart aux
(XIIème siècle) et (XIIIème siècles), vague majeure de
construction de Cathédrales. Pour pallier la
vétusté des locaux, ou pour réparer après
un incendie, voire simplement par goût d'imitation et de
modernité, comme à Paris où le projet de Notre
Dame est mis en oeuvre (20) ans après un important
embellissement, on commença à ériger ces
églises géantes que sont le cathédrales Gothiques
du bassin parisien.
Désormais,
il n'y eut plus qu'une seule église, l'habitude des
cathédrales doubles ayant disparu avec les progrès de la
christianisation des populations. Peu à peu, une des 2
églises concentra les honneurs et les embellissements, devenant
plus grande que l'autre après chaque
réaménagement. A Paris, à la suite de invasions
Normandes, on ne prit même plus soin de relever St Etienne
à côté de Notre Dame. Cependant, cette tradition
perdura dans certains lieux, à Lyon par exemple, jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime, une petit église resta
adossée à la cathédrale St Jean. Dans le Midi, on
conserva l'usage d'églises doubles, l'une étant
réservée aux chanoines l'autre aux paroissiens.
- les Chanoines et l'Evêque
L'institution
Canoniale est aussi ancienne que l'épiscopat, et si l'expression
"canonicus" n'apparaît dans les textes que vers (535), c'est
simplement parce que le développement du clergé rural
obligea à désigner d'un terme spécifique les
religieux gravitant autour de l'évêque et l'aidant dans
ses fonctions sacerdotales. Les chanoines ont, semble t-il, très
tôt partagé la vie de l'évêque, comme en
témoignent les exemples de St Augustin d'Hippone et d'Isidore
de Séville. Mais il faut attendre la période
Carolingienne pour voir triompher le principe d'une vie en commun pour
l'ensemble de ces clercs. En (816), le concile d'Aix La Chapelle
diffusa une règle de vie pour les chanoines avec obligation de
la clôture. Cette décision législative
répondait à une attente de l'épiscopat de
l'époque, comme l'atteste le développement dans les
diocèses de la règle instituée pour ses chanoines
par l'archevêque de Metz, Chrodegang, au milieu du
(VIIIème siècle). Il s'agissait avant tout de parfaire la
pratique du chant Romain par ces clercs dont la fonction principale est
liturgique.
L'institution
Canonicorum, bien que plus souple que la règle
Bénédictine, s'imposa mal dans les chapitres. Sa
souplesse même, par exemple la "possibilité pour les
malades, les clercs enseignant, etc, de ne pas vivre dans le
cloître" renforçait les dérogations et
dévalorisait son contenu aux yeux de chanoines craignant de
passer pour des moines de 2ème ordre. Cependant, au fil des
(IXème siècle) et (Xème siècles), l'institution structura,
même si les maisons individuelles étaient
préférées au cloître. Obligés de
fournir un revenu à leurs chanoines, les évêques
tendaient de plus en plus à leur donner une mense propre qu'ils
géraient en toute indépendance. Celle ci était
à son tour partagée en prébendes selon le nombre
de chanoines. Poussés par Réforme Grégorienne, les
évêques tentèrent de réintroduire une vie
communautaire au sein des chapitres.
L'évêque
Manfred augmenta ainsi les revenus de celui de Béziers et
construisit 2 blocs de maisons au Nord et à l'Est de sa
cathédrale. Des cloîtres furent aussi érigés
à Auch et Carpentras. Malgré l'ardeur apostolique de ses
auteurs, ce principe ne réussit pas à s'imposer.
Dès le milieu du (XIIème siècle), à
quelques exceptions près comme le chapitre d'Uzès, la
plupart des chanoines avaient regagné les maisons l'enclos
canonial.
- le Rôle du chapitre
Disposant
de ses propres revenus, le chapitre gagna en autonomie et en
importance. Il devint un acteur de la cathédrale avec lequel
l'évêque eut de plus en plus affaire dans la
réalisation de ses projets architecturaux, d'autant plus que
l'évolution économique ne lui permit plus d'agir seul.
Ainsi, à Beauvais en (1225), Milan de Nanteuil signa avec son
chapitre une charte répartissant le financement de la
construction de la nouvelle cathédrale. A Toulouse et à
Narbonne, le chapitre devint le principal entrepreneur du chantier,
même si l'évêque restait à l'origine du
projet. L'édification de la cathédrale de Narbonne a
laissé de nombreux documents permettant d'avoir une idée
du montage financier et du contrôle des travaux, en (1267),
l'archevêque Maurin et le chapitre s'accordaient sur leurs
contributions respectives à l'oeuvre nouvellement
commencée, le prélat s'engageait à verser 5.000
sous par an, tandis que les chanoines donneraient 50 livres, le
revenu des annates étant consacré à l'oeuvre.
La
gestion des travaux était partagée avec les chanoines, au
sommet, 2 chanoines ouvriers, contrôlaient les finances de la
fabrique. Ils étaient élus pour un an par
l'archevêque et le chapitre. Si la contribution de
l'évêque était importante au commencement, comme le
prescrivait le droit canon, il devait manifester son aval à la
construction d'un nouvel édifice religieux par un don, elle se
réduisit drastiquement par la suite. Les successeurs de Maurin
ne donnèrent plus que pour la construction de parties bien
définies de l'édifice, ainsi Pierre de Montbrun
bâtit la chapelle St Pierre pour y établir sa
sépulture. Ils manifestèrent même un certain
désintérêt pour l'achèvement de la
réalisation, comme en témoigne leur passivité face
au procès qui opposa au (XIVème siècle) le
chapitre et les consuls de la ville, quand la poursuite de la
construction menaça la muraille de la cité.
Le
cas de la réalisation du choeur Gothique de St Etienne de
Toulouse illustre le même rapport entre, évêque et
chapitre dans la construction de la cathédrale. Mais, il permet
aussi de comprendre qu'il est délicat de savoir quelle
était la part réelle de l'évêque dans
l'entreprise. Une tradition reprenant la "Galliia Christiana", recueil du
(XVème siècle), attribuait à l'évêque
Bertrand de L'lsle Jourdain l'érection du choeur à partir
de (1272). Or, les sources du (XIIIème siècle) ne
décrivent à aucun moment Bertrand comme un grand
bâtisseur. D'ailleurs dans son testament de (1279), il ne
léguait que 500 livres pour l'oeuvre de la cathédrale
auxquelles s'ajoutaient 100 livres pour l'ornementation, alors que sa
fortune personnelle est estimée à 120.000 livres. (7)
ans plus tard, il augmenta sa dotation, offrant 1.000 livres pour la
chapelle des St Simon et St Jude. Et de fait, cette chapelle, qui se
situe dans l'axe de l'église, est ornée à la
croisée d'ogives d'une figure d'évêque,
probablement Bertrand lui même. Ainsi, à la lumière
des sources contemporaines, il faut réviser à la baisse
l'action de cet évêque, car si le projet de St Etienne a
été arrêté vers (1270) et ne fut que peu
modifié par la suite, la construction du choeur s'étira
jusqu'en (1370).
La
vie liturgique des chanoines, clergé spécifique de la
cathédrale, est rythmée par les heures Canoniales:
"matines, laudes, messe, vêpres, complies", auxquelles s'ajoutent
"prime, sexte et none, le Dimanche". C'est pour protéger leur
prière qu'une clôture et un jubé furent
dressés autour du choeur de l'église toujours
animée. L'évêque, lui, était rarement
présent, comme en témoigne les "libri ordinarii" livres
des coutumes liturgiques de l'église, qui prévoient
souvent même pour les grandes cérémonies
l'hypothèse de l'absence de l'évêque. Au
(XIVème siècle) encore, la possibilité offerte par
Pie V aux diocèses ayant une liturgie ancienne de plus de
(200) ans d'adopter la liturgie Romaine qui était suspendue au
consentement du chapitre.
Les
vicissitudes du mode de choix de l'évêque avaient
d'ailleurs totalement dépossédé celui ci de sa
cathédrale à partir du (XIVème siècle). Si
les chanoines perdirent au (XVème siècle) le droit
d'élection épiscopale, la perte de ce privilège au
profit du Roi de France renforça l'absentéisme des
nouveaux prélats qui, serviteurs du souverain, recevaient leur
siège comme une récompense. Accaparés par leurs
obligations auprès du Roi, ils séjournaient peu dans leur
diocèse, d'autant plus que souvent ils cumulaient les
bénéfices. Ainsi, au (XVème siècle), le
fameux Pierre Cauchon, juge de Jeanne d'Arc, ne se rendit jamais dans
les évêchés de Beauvais et de Lisieux. Si la
Réformation Catholique voit l'apparition d'une
générations d'évêques compétents et
consciencieux, elle ne modifia en rien l'équilibre au sein de la
cathédrale, qui resta avant tout l'église des chanoines
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
- la Révolution Française
Institution
communautaire et religieuse, le chapitre cathédrale fut
balayé par la Révolution françaises.
Privées de revenu à la suite de la nationalisation des
biens du clergé le 2 Novembre (1789), les communautés
Canoniales connurent les affres de la division entre constitutionnels
et réfractaires et subirent les violences des vagues
anticléricales, qui marquèrent la France à partir
de (1792). Si la chute de Robespierre mit fin à l'engrenage
d'une Révolution prise dans un vertige de pureté,
l'Eglise catholique, trop liée au parti monarchiste, ne retrouva
la paix et la sérénité que sous le consulat.
Divisée, ébranlée mais respirant d'un nouveau
souffle, elle trouvait là un cadre nouveau, apte à la
reconquête des âmes.
Le
Concordat, signé le 11 Juillet (1801), entérina
définitivement l'adoption du découpage département
pour les diocèses réduisant ainsi leur nombre à
60 pour la France actuelle. Pour éviter une querelle entre
constitutionnels et réfractaires, tous les évêques
furent appelés auparavant à démissionner, et les
nouvelles nominations furent l'occasion d'un profond renouvellement du
corps épiscopal. Devant prêter serment de
fidélité, entre les mains du 1er consul, les
évêques devinrent comme les curés de paroisse des
fonctionnaires. Le concordat rétablit aussi les chapitres
canoniaux, mais privés de revenus, sans pouvoir auprès
d'un évêque nommé par l'Etat, les chanoines
n'eurent plus désormais de poids dans la gestion de la
cathédrale. L'évêque n'en fut pas libre pour
autant, car l'Etat était devenu propriétaire des
édifices cathédrales dont le prélat n'avait que
l'usufruit cultuel, et leur gestion incomba désormais au Service
des bâtiments diocésains.
L'évêque doit donc
composer avec les architectes de l'administration publique,
ancêtres des architectes des Monuments Historiques, ils
marquèrent souvent profondément le visage de nos
cathédrales, le plus célèbre d'entre eux
étant Eugène Viollet le Duc (1814)-(1879). Le patrimoine
cultuel avait particulièrement souffert pendant la
période révolutionnaire. Les flambée de violences
antireligieuses ou anti monarchiques mirent à mal nombre de
portails, et à partir du Directoire les coups de pioches
d'entrepreneurs mercantiles démolirent plusieurs édifices
comme la cathédrale de Cambrai de (1798) à (1820). Ainsi
disparurent tout ou en partie une dizaine de cathédrales.
- Cathédrales, ou
Monuments Historiques
Les
réaménagements, les reconstructions, les restaurations
eurent lieu dans un climat spirituel bien particulier. Le
(XIXème siècle) fut une période hautement
religieuse avec ses Saints et ses mystiques, pourtant la
déchristianisation progressa dans les masses. Apparu au grand
jour avec la Révolution, accentué par l'exode rural et
l'industrialisation, ce phénomène ne put être
endigué par l'Eglise. Pourtant, ses efforts furent nombreux et
les entreprises architecturales de l'époque doivent être
aussi comprises sous cet angle. Face à l'agitation politique et
sociale, le catholicisme voulut apparaître comme un pôle de
stabilité. Pour l'épiscopat français, il
était impératif de montrer la force de l'Eglise dans une
société qu'elle ne contrôle plus. Les chantiers
d'églises furent l'un des moyens de manifester ce qui se voulait
être une vitalité retrouvée, l'évêque
du (XIXème siècle) soutint toujours, quand il ne les
suscita pas, les travaux dans la cathédrale. Monseigneur Cousseau
joua ainsi un rôle important dans l'adoption du d'Abadie,
reconstructeur de St Front de Périgueux, en décidant
d'affubler d'un dôme la croisée de St Pierre
d'Angoulême.
Noublions
pas, cependant, que ces chantiers résultaient aussi d'une
redécouverte du Moyen Age, et la naissance d'une
connaissance scientifique de l'art Roman et de l'art Gothique.
Classées pour la plupart Monuments Historiques en (1830), les
cathédrales furent de plus en plus considérées par
l'Etat uniquement sous leurs aspects historiques et artistiques, et les
évêques connurent parfois des difficultés à
réaliser les aménagements envisagés pour le
service cultuel, ce qui n'empêcha pas la poursuite du
démantèlement des structures Médiévales,
comme les jubés, qui disparurent ainsi du paysage
cathédrale français. En (1873), par exemple, Monseigneur
Bourret, alors évêque de Rodez réussit,
malgré les résistances, à déplacer le
jubé flamboyant dans le croisillon Nord de sa cathédrale.
Plus
original fut le sort réservé au mobilier classique dont
on se souciait encore peu, la réhabilitation de la
cathédrale Médiévale ayant entraîné
le développement d'un mépris pour tous les
aménagements postérieurs, on débaroquisa beaucoup
à la fin du siècle au profit d'un mobilier Néo
Gothique. Selon J-M Leniaud Les cathédrales du (XIXème
siècle), cet engouement ecclésiastique pour le
Néo Gothique es rapprocher paradoxalement de la vague
ultramontaine, qui saisit le clergé français après
(1830). En tout cas, l'art Médiéval est associé
dans l'esprit des catholiques de l'époque à l'expression
d'une société totalement chrétienne, le
classicisme symbolisant le rationalisme des Lumières. Ainsi,
Monseigneur Nanquette (1855)-(1861) fît démolir le mobilier
du choeur de la cathédrale du Mans, mis en place vers (1770),
puis celui des chapelles rayonnantes qui ne datait que de (1814).
Ces
entreprises peuvent parfois être taxées de vandalisme, et
rares sont les réalisations du (XIXème siècle) qui
ne soulèvent pas la critique. L'une des mieux acceptées,
est l'achèvement de la cathédrale de Limoges, par la
volonté de Monseigneur Duquesnoy. Désirant relier au
reste de l'église le clocher du (XVème siècle), il
fit construire de (1877) à (1888) un narthex et 3
travées. Une étude longue et minutieuse,
déjà en (1849), Viollet le Duc
réfléchissait au projet, et le respect du
désaxement et du style flamboyant de la tour donnèrent
à ce chantier un caractère bien différent de celui
des opérations de Périgueux et d'Angoulème.
Pourtant, dans l'esprit de l'instigateur épiscopal, il
s'agissait toujours de manifester la vigueur de l'Eglise catholique.
- et Aujourd'hui ?
Depuis
la consécration de la cathédrale d'Evry, nous savons que
les, chantiers cathédrales, ne sont pas des entreprises du
passé. Cependant sur 8 nouveaux diocèses
créés en France depuis (1966), 2 seulement ont fait
l'objet d'une construction nouvelle. Les évêques des
villes nouvelles de la banlieues Parisienne ont au départ
refusé la construction de cathédrales. Il ne fallait pas
imposer l'Eglise à des populations,
déchristianisées. C'est par volonté
ecclésiastique que l'on refusa le monumental dans les
années (1960)-(1970), de même qu'Evry est le fruit d'une
décision de Monseigneur Herbulot de transférer son
évêché de Corbeil chef lieu de l'Essonne.
On
le voit, la relation entre l'évêque et la
cathédrale n'est pas linéaire, elle a été
la conséquence de nombreux facteurs, à la fois religieux,
sociaux et culturels, et l'on ressent cette évolution dans la
plupart des cathédrales anciennes. Il ne s'agissait ici que d'en
retracer les grandes lignes. Les cathédrales que nous avons
devant les yeux ne sont pas celles du Moyen Age, mais celles de
la fin du (XXème siècle). Nombre des
générations, nombre d'évêques y ont
laissé leurs marques. Il serait peut être
intéressant d'étudier la part des principaux
évêques dans l'érection d'édifices actuels,
et de vérifier par exemple, si activité de construction
et vigueur pastorale sont toujours liées. Certaines
périodes charnières ou particulièrement
marquantes, comme le (XIIème siècle), ou la
Réformation catholique nécessiteraient des exposés
spécifiques.
Haut de page
|